Ce fut un réveil brutal auquel j’ai eu droit samedi dernier. Ça martelait dans ma tête me rappelant, à tous moments, les excès de la veille. La nuit a été courte. Trop courte même. Nous avions eu une belle soirée la veille alors que nous fêtions l’anniversaire du collègue Stephen. Depuis le temps qu’il en parlait. Bref.
Mais voilà, Maxim est déjà habillée en ballerine me démontrant qu’il était hors de question que nous rations son rendez-vous avec les pointes et les tutus. Pourtant je n’ai qu’une envie. Me laver les dents, prendre deux Tylenols et me recoucher au plus vite.
C’est avec toutes les misères du monde que je parviens à me tirer du lit. Pour faire exprès, les filles sont énervées comme ce n’est pas possible. Ce n’est pas une tempête qui s’abattra sur nous, c’est un ouragan si j’en juge leur comportement que l’on pourrait juger d’agité.
L’idée me passe d’appeler leur père pour qu’il me remplace. Mais il a eu l’idée d’aller encourager les Alouettes à Montréal. Ma mère ? En réunion électorale. Mon père, ma sœur travaillent. Je n’ai donc pas le choix. Soupir.
Arrivée sur place, je suis gagnée par l’excitation de ma grande. Elle fait la révérence, pointe du pied, fait des tourniquettes. Elle exécute ses mouvements avec précision, ardeur et joie.
En sortant de la session de ballet, les filles me demandent d’aller marcher au Marais St-François. J’hésite un moment. L’appel du divan est encore assez fort. L’envie de m’y coucher, en pyjama, avec un doudou et de regarder les insignifiantes émissions du samedi matin me plaît assez.
« Ok, mais pas trop longtemps », ai-je concédé.
Arrivée sur place, je me laisse prendre au jeu. Filou est émerveillée devant les multiples feuilles mortes qu’elle trouve sur son chemin. Maxim est à la recherche d’oiseaux, de canards, de couleuvres peut-être. Pendant ce temps, j’immortalise ces sourires avec mon appareil photo.
Les petites courent le long des sentiers. Elles rigolent. S’inventent des jeux. Parlent aux gens qu’elles croisent. S’interrogent sur les espèces d’arbres ou de plantes qu’elles rencontrent. Elles sont définitivement contentes que j’ai acquiescé à leur demande de venir ici.
Les puces ont raison. En cette rare journée d’automne où le soleil est présent, le décor est magnifique, la température est idéale. L’air frais nous fait le plus grand bien.
La preuve ? Mon mal de tête est parti. Et malgré la croyance populaire, ce n’est pas Aspirine qui a réglé ça, mais l’émerveillement sans borne de mes cocottes devant ce magnifique spectacle.
26 octobre 2005
16 octobre 2005
Ma politique à moi
Il arrive souvent que l’on me demande pourquoi je ne jase jamais politique dans cette chronique. Pourquoi je ne prends pas position dans la course à la chefferie du Parti Québécois. Quand est-ce que je commenterai la campagne électorale municipale. Soyez patient, ce ne sera pas demain la veille.
Non pas que je me désintéresse de la politique. La politique fait partie de ma vie comme d’autres carburent à la philatélie ou au trekking. Et ce, depuis toujours.
Mon premier souvenir remonte à loin. Je devais avoir sept ou huit ans. J’avais passé la journée entière le nez collé sur la télévision à suivre la course à la chefferie qui opposait Pauline Marois à Pierre-Marc Johnson. J’espérais fermement que Madame Marois remporte la course. Une femme première ministre, wow !
Nombre de professeurs que j’ai traumatisé en leur affirmant que lorsque je serai grande, je serai première ministre du Canada. Dans ma famille, chez mes amis, c’était acquis. Je deviendrai politicienne. Être professeur, infirmière ou secrétaire, très peu pour moi.
Les années ont passé. Puis, ma belle-mère s’est présentée aux provinciales en 1994. J’ai jasé avec Parizeau sur un bateau sur le Memphré, rencontré Bouchard dans un sous-sol d’église, joué à la balle avec Marois. Quelle chance de rencontrer ces grands, moi qui aspirait à être des leur un de ces quatre.
Malgré tout, plus les semaines avançaient et plus j’étais déçue de ce que je voyais. Plus le jour « J » approchait et moins l’idée de me lancer en politique me tentait. Cette histoire d’image qui primait sur les idées me répugnait. Ces obstinations sur les virgules à ajouter ou à enlever sur le dépliant de la candidate me tapaient sur les nerfs. On oubliait l’essentiel.
Ma belle-mère a perdu. Nous avons pleuré pendant des semaines. Nos rêves de changer le monde s’étaient écroulés en une seule journée où 4 000 personnes ont préféré son adversaire.
Ginette avait peut-être mis de la brume dans les lunettes de son adversaire, mais cette campagne électorale en a mis dans mes aspirations politiques également.
Ma mère s’est retrouvée à travailler pour différents députés autant au fédéral qu’au provincial. Mon père s’est, quant à lui, investi au niveau municipal. Chaque souper de famille amène avec lui un lot de discussions sur les dernières interventions d’un tel, sur le scandale d’un autre. Nous analysons et commentons le tout. Et j’avoue que ça me suffit amplement.
Ma mouman est présentement en campagne. Elle dort quatre heures par nuit, ne m’appelle plus deux fois par jour et son chat ne la reconnaît plus. C’est admirable de la voir se défoncer pour un but, mais je n’ai pas envie de vivre de cette façon.
Je veux voir mes enfants grandir. Je veux leur donner leur bain. Je veux faire les devoirs avec Maxim. Je veux écouter Filou me raconter sa journée à la garderie. Je veux respirer. Je veux vivre.
Je ne serai jamais première ministre du Canada, député du comté d’Orford ou conseillère de St-Élie, Non. Je n’ai pas renoncé à mes buts pour le moins. Moi, ma politique je la fais autrement. En écrivant dans ce journal.
Non pas que je me désintéresse de la politique. La politique fait partie de ma vie comme d’autres carburent à la philatélie ou au trekking. Et ce, depuis toujours.
Mon premier souvenir remonte à loin. Je devais avoir sept ou huit ans. J’avais passé la journée entière le nez collé sur la télévision à suivre la course à la chefferie qui opposait Pauline Marois à Pierre-Marc Johnson. J’espérais fermement que Madame Marois remporte la course. Une femme première ministre, wow !
Nombre de professeurs que j’ai traumatisé en leur affirmant que lorsque je serai grande, je serai première ministre du Canada. Dans ma famille, chez mes amis, c’était acquis. Je deviendrai politicienne. Être professeur, infirmière ou secrétaire, très peu pour moi.
Les années ont passé. Puis, ma belle-mère s’est présentée aux provinciales en 1994. J’ai jasé avec Parizeau sur un bateau sur le Memphré, rencontré Bouchard dans un sous-sol d’église, joué à la balle avec Marois. Quelle chance de rencontrer ces grands, moi qui aspirait à être des leur un de ces quatre.
Malgré tout, plus les semaines avançaient et plus j’étais déçue de ce que je voyais. Plus le jour « J » approchait et moins l’idée de me lancer en politique me tentait. Cette histoire d’image qui primait sur les idées me répugnait. Ces obstinations sur les virgules à ajouter ou à enlever sur le dépliant de la candidate me tapaient sur les nerfs. On oubliait l’essentiel.
Ma belle-mère a perdu. Nous avons pleuré pendant des semaines. Nos rêves de changer le monde s’étaient écroulés en une seule journée où 4 000 personnes ont préféré son adversaire.
Ginette avait peut-être mis de la brume dans les lunettes de son adversaire, mais cette campagne électorale en a mis dans mes aspirations politiques également.
Ma mère s’est retrouvée à travailler pour différents députés autant au fédéral qu’au provincial. Mon père s’est, quant à lui, investi au niveau municipal. Chaque souper de famille amène avec lui un lot de discussions sur les dernières interventions d’un tel, sur le scandale d’un autre. Nous analysons et commentons le tout. Et j’avoue que ça me suffit amplement.
Ma mouman est présentement en campagne. Elle dort quatre heures par nuit, ne m’appelle plus deux fois par jour et son chat ne la reconnaît plus. C’est admirable de la voir se défoncer pour un but, mais je n’ai pas envie de vivre de cette façon.
Je veux voir mes enfants grandir. Je veux leur donner leur bain. Je veux faire les devoirs avec Maxim. Je veux écouter Filou me raconter sa journée à la garderie. Je veux respirer. Je veux vivre.
Je ne serai jamais première ministre du Canada, député du comté d’Orford ou conseillère de St-Élie, Non. Je n’ai pas renoncé à mes buts pour le moins. Moi, ma politique je la fais autrement. En écrivant dans ce journal.
10 octobre 2005
J’ai le mors aux dents
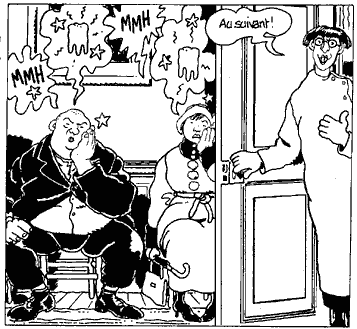
Je vous ouvre un grand pan de ma vie ce matin. Une petite gêne que je me réservais. Mais voilà, je ne peux plus garder ça pour moi. Et surtout, j’ai vraiment mal.
Mes dents se dérobent de leur obligation. Elles manquent à leur tâche de me protéger contre ces caries qui se veulent si agressantes. Je serre les dents.
Alors que certains doivent rivaliser d’imagination pour camoufler leur crâne dégarni, moi je carbure à l’Advil. Pendant que d’autres doivent intégrer le lavage de lentilles de contact à leur quotidien, moi je suis devenue la plus grande consommatrice d’Oragel au monde. Tandis que vous vous taper une troisième migraine cette semaine, je dois composer avec un budget déficitaire because j’ai une déficience en émail. Ça me fait grincer des dents.
Pourtant, je respecte les règles élémentaires en matière de santé buccodentaire. J’utilise plusieurs kilomètres de soie dentaire chaque année. J’observe les trois minutes réglementaires d’un brossage bi-journalier. Je ne bois ni café, ni boisson gazeuse et je maintient ma consommation de sucre au plus bas. Je pousse même mes habitudes jusqu’à me gargariser chaque jour avec du fluor. Mais rien n’y fait. Snif.
Pour la cinquième fois en autant d’années, je dois faire face à un diagnostic fort déprimant ; traitement de canal à faire sur une molaire.
C’est que mes caries à moi trouvent mes racines dentaires fort confortables j’imagine. Un confort qui coûte la peau des fesses croyez-moi : 600$ au minimum. Faites le calcul. J’ai une véritable mine d’or dans la bouche !
Je vous jure que tous les dentistes de la ville se bousculent pour m’avoir comme cliente. Une patiente comme moi, ça rentabilise un prêt étudiant assez vite merci.
D’ailleurs, c’est quelque chose que je n’ai jamais compris. Pourquoi les soins dentaires ne sont pas couverts par le régime d’Assurance-maladie du Québec ? Pourtant, les dents sont une partie intégrante du corps non ? Moi, j’aimerais bien mieux présenter ma carte soleil plutôt que ma carte de guichet quand je me pointe chez le dentiste.
Tout ça, c’est sans compter la peur qui me tressaille à chaque visite dans ces cabinets. Les piqûres dans le palais, ce n’est pas ce qu’il y a de plus jojo. Jumelé avec le fait que j’ai besoin de deux fois plus de novocaïne que la normal, donc deux fois plus d’aiguilles, je claque des dents.
Face à ce triste constat, il me reste que deux choix : porter une prothèse dentaire ou marier un dentiste. J’aime mieux la deuxième idée !
05 octobre 2005
Un rhume qui cajole
Ma loulou est moche. Je sens un vilain virus l’envahir. Elle parle comme Brian Mulroney et ses yeux sont pleins de dodo. Et mon cœur de maman est triste à chaque fois que ces méchants microbes se pointent chez moi. Je suis incapable de m’habituer à ces invasions.
La cocotte s’est levée marabout hier matin. Dès les premières paroles qu’elle m’a lancées, pour ne pas dire garochées, j’ai senti qu’il y avait quelque chose qui clochait. Elle, qui habituellement, est pleine de vie, était remplie d’impatience.
Elle se pointe devant les marches et avec une mine toute découragée, elle m’implore de faire l’ascenseur. Filou est trop fatiguée pour les gravir, me dit-elle.
Ma petite s’installe devant la télé. Ce sont les nouvelles du sport et ça ne semble pas l’importuner pour deux cennes alors qu’habituellement, pas grand-chose d’autre que les princesses ou les Calinours peuvent défiler à l’écran.
Décidément, ça ne marche pas.
Je m’assois à côté d’elle question de vérifier si elle est fiévreuse. J’en profite pour lui flatter le dos tout tranquillement. « Maman d’amour, fais-moi des dessins dans le dos s’il te plait. » Comment refuser ?
Je laisse ma sauce à spagh et le bain à laver en plan. J’y reviendrai plus tard. De toute façon, c’est beaucoup plus plaisant de dessiner que de faire du ménage hein ?
La voilà rassasiée de dessins tactiles. Il était temps, ça sent le brûlé. Les oignons ont collé. Je m’affaire à tenter de récupérer la sauce. La voilà qui s’accroche à mes pantalons (Félixe, pas ma sauce). « Maman, je veux m’asseoir sur le comptoir et te regarder faire la sauce à spagh. »
Je lui déniche une petite place entre le robot culinaire et le monticule de vaisselle à laver. Sans dire un mot, elle m’observe couper l’aubergine, laver les piments, épépiner les tomates. Sans un mot, elle regarde dans le chaudron où les saveurs de basilic et d’ail se mêlent et hume l’odeur de son met favori.
Une fois le couvercle posé, la voilà bien triste. « Maman, veux-tu me raconter une petite histoire s’il te plait ? » Hum. Moi qui avais prévu terminer les rénos de la salle de bain aujourd’hui. Je suis un peu à bout de prendre ma douche entre les pots de peinture, l’escabeau et la sableuse.
« C’est l’heure. Simon fait la grimace. Il enfile son pyjama, démêle ses cheveux, boit un grand verre de lait ; se débarbouille de la tête aux pieds et se brosse soigneusement les dents. Puis, il monte l’escalier, tape son oreille, pousse ses couvertures et plonge dans son lit. Tous les soirs du monde, c’est pareil. Le papa de Simon monte l’escalier, il s’installe à côté de son fils et se prépare à endormir la planète. »
Pendant ma lecture, ma puce se love tout contre moi toute attentive à mon histoire. Plus rien ne compte pour nous que les aventures rocambolesques que le papa de Simon raconte. Je tourne la dernière page.
Ma loulou a le rhume. Ce n’est pas si triste que cela finalement. Parce que lorsque la maladie sévit chez moi, c’est l’occasion de prendre le temps avec mes puces. Quelque chose que j’oublie trop souvent. Vivement l’hiver !
La cocotte s’est levée marabout hier matin. Dès les premières paroles qu’elle m’a lancées, pour ne pas dire garochées, j’ai senti qu’il y avait quelque chose qui clochait. Elle, qui habituellement, est pleine de vie, était remplie d’impatience.
Elle se pointe devant les marches et avec une mine toute découragée, elle m’implore de faire l’ascenseur. Filou est trop fatiguée pour les gravir, me dit-elle.
Ma petite s’installe devant la télé. Ce sont les nouvelles du sport et ça ne semble pas l’importuner pour deux cennes alors qu’habituellement, pas grand-chose d’autre que les princesses ou les Calinours peuvent défiler à l’écran.
Décidément, ça ne marche pas.
Je m’assois à côté d’elle question de vérifier si elle est fiévreuse. J’en profite pour lui flatter le dos tout tranquillement. « Maman d’amour, fais-moi des dessins dans le dos s’il te plait. » Comment refuser ?
Je laisse ma sauce à spagh et le bain à laver en plan. J’y reviendrai plus tard. De toute façon, c’est beaucoup plus plaisant de dessiner que de faire du ménage hein ?
La voilà rassasiée de dessins tactiles. Il était temps, ça sent le brûlé. Les oignons ont collé. Je m’affaire à tenter de récupérer la sauce. La voilà qui s’accroche à mes pantalons (Félixe, pas ma sauce). « Maman, je veux m’asseoir sur le comptoir et te regarder faire la sauce à spagh. »
Je lui déniche une petite place entre le robot culinaire et le monticule de vaisselle à laver. Sans dire un mot, elle m’observe couper l’aubergine, laver les piments, épépiner les tomates. Sans un mot, elle regarde dans le chaudron où les saveurs de basilic et d’ail se mêlent et hume l’odeur de son met favori.
Une fois le couvercle posé, la voilà bien triste. « Maman, veux-tu me raconter une petite histoire s’il te plait ? » Hum. Moi qui avais prévu terminer les rénos de la salle de bain aujourd’hui. Je suis un peu à bout de prendre ma douche entre les pots de peinture, l’escabeau et la sableuse.
« C’est l’heure. Simon fait la grimace. Il enfile son pyjama, démêle ses cheveux, boit un grand verre de lait ; se débarbouille de la tête aux pieds et se brosse soigneusement les dents. Puis, il monte l’escalier, tape son oreille, pousse ses couvertures et plonge dans son lit. Tous les soirs du monde, c’est pareil. Le papa de Simon monte l’escalier, il s’installe à côté de son fils et se prépare à endormir la planète. »
Pendant ma lecture, ma puce se love tout contre moi toute attentive à mon histoire. Plus rien ne compte pour nous que les aventures rocambolesques que le papa de Simon raconte. Je tourne la dernière page.
Ma loulou a le rhume. Ce n’est pas si triste que cela finalement. Parce que lorsque la maladie sévit chez moi, c’est l’occasion de prendre le temps avec mes puces. Quelque chose que j’oublie trop souvent. Vivement l’hiver !
S'abonner à :
Messages (Atom)
